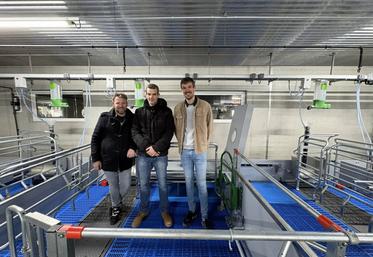Préserver la culture de la sécheresse du printemps
Le semis d’orge de printemps à l’automne est une pratique de plus en plus répandue. Certains agriculteurs
y voient un moyen d’organiser leurs chantiers et d’autres d’échapper aux périodes de stress hydrique et thermique du printemps.
Le semis d’orge de printemps à l’automne est une pratique de plus en plus répandue. Certains agriculteurs
y voient un moyen d’organiser leurs chantiers et d’autres d’échapper aux périodes de stress hydrique et thermique du printemps.

« Semer tôt l’orge de printemps permet de décaler son cycle, explique Florent Thiebaut, conseiller du CETA de Romilly-sur-Seine (Aube). Lors de la période de stress hydrique et thermique de la fin du printemps, elle se trouve à un stade moins sensible et préjudiciable au remplissage du grain. »
Plus de vigilance technique
Pour Florent Thiebaut, le créneau idéal pour semer de l’orge de printemps à l’automne se situe début novembre, en veillant à ce que la structure du sol ne soit pas compactée. Un semis plus précoce amplifie le risque de levées d’adventices, de développement de maladies et d’exposition au gel de la culture. « L’orge de printemps semée à l’automne craint surtout le gel de fin d’hiver, au moment où elle commence à redémarrer ou que l’épi est décollé », précise-t-il. Toutefois, depuis quelques années, le nombre de jours de gel est de moins en moins fréquent. Pour assurer la réussite de la technique, Alexandre Ployez, agriculteur à Champfleury (Aube) sème de la semence certifiée à une densité de semis majorée à 350 grains/m² pour compenser les 10 à 20 % de pertes potentielles de pieds. « RGT Planet reste la variété de référence pour ce genre de pratique parce qu’elle est rustique, très cultivée et bien connue, souligne Florent Thiebaut. Cependant, semée tôt, elle est aussi exposée au risque de développer des maladies fongiques. » Alexandre Ployez convient que cette technique nécessite le passage d’un fongicide supplémentaire, à demi-dose, en comparaison à un semis de printemps.
En cas d’application d’un désherbant d’automne, il est préconisé d’enterrer correctement la semence pour éviter des problèmes de sélectivité. « Si la parcelle est connue pour être infestée en graminées, je ne conseille pas cette pratique, souligne Florent Thiebaut. Les herbicides antigraminées sont peu sélectifs de la culture et peuvent la sensibiliser au gel. » Des variétés avec un meilleur comportement face au froid et au désherbage d’automne sont en cours d’inscription avec des résultats qui restent encore à confirmer.
Quant à l’application d’insecticides, elle n’est pas systématique et dépend de l’année climatique et de l’infestation en pucerons. Généralement, une orge de printemps semée à l’automne présente moins de risque qu’un blé car son semis est plus tardif.
Des bénéfices technico-économiques
Alexandre Ployez apprécie cette technique car elle lui permet de lisser ses pics de travail, notamment au printemps, et de semer ensuite un maïs ou un sorgho en tant que Cive (culture intermédiaire à vocation énergétique) pour alimenter son méthaniseur. « Je sème 70 % de ma sole d’orge de printemps à l’automne, après les récoltes de blé, d’orge de printemps et de betterave, explique-t-il. Les bons créneaux météo sont souvent plus favorables qu’entre le 15 février et le 1er mars et surtout l’orge est moins exposée aux coups de sec du printemps qui impactent le rendement. » Depuis quatre ans qu’il pratique cette technique, Alexandre Ployer produit en moyenne 10 quintaux supplémentaires par hectare par rapport à un semis de printemps et produit en moyenne 85 q/ha. « Malgré des charges en fongicides plus importantes que l’itinéraire cultural classique, cette pratique apporte une certaine plus-value, convient Florent Thiebaut. La marge nette reste supérieure à un semis de printemps, avec des écarts plus ou moins marqués selon le contexte économique des charges et le cours de l’orge. » •